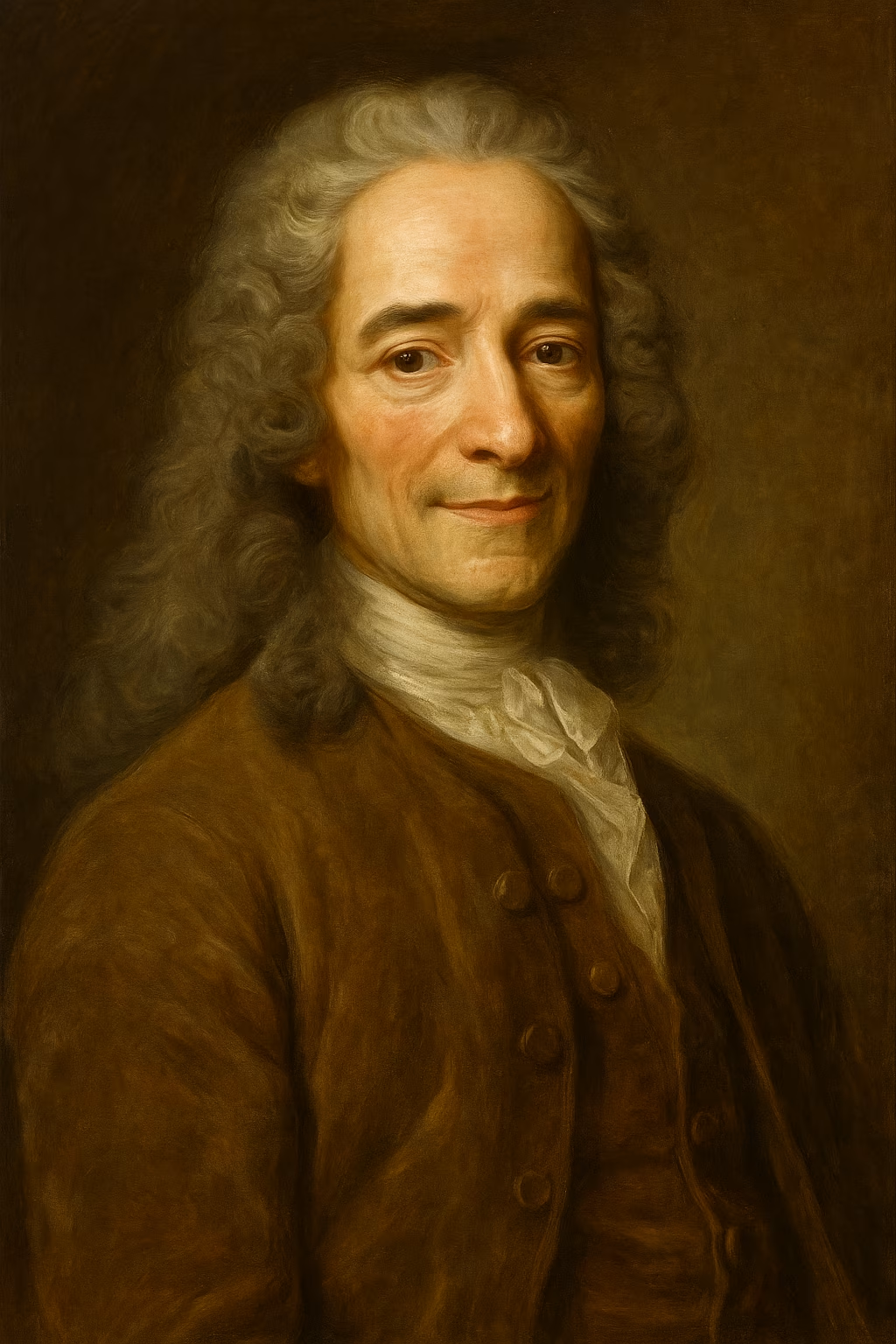Catherine II de Russie (1729 – 1796)
Résumé rapide
Catherine II de Russie (1729 – 1796) est une impératrice de russie figure majeure de l'histoire. Née à Stettin, duché de Poméranie, royaume de Prusse (aujourd’hui Szczecin, Pologne), Catherine II de Russie a marqué son époque par publication du nakaz et convocation de la commission législative.

Naissance
2 mai 1729 Stettin, duché de Poméranie, royaume de Prusse (aujourd’hui Szczecin, Pologne)
Décès
17 novembre 1796 Saint-Pétersbourg, Empire russe
Nationalité
Russe
Occupations
Biographie complète
Origines et Enfance
Née Sophie-Frédérique-Auguste d’Anhalt-Zerbst le 2 mai 1729, Catherine provient d’une petite principauté protestante du Saint-Empire. Son père Christian-Auguste, général prussien au service de Frédéric-Guillaume Ier, gouverne la garnison de Stettin ; sa mère Johanna-Élisabeth de Holstein-Gottorp nourrit d’ambitions dynastiques pour sa fille. L’enfance de Sophie se déroule entre rigueur militaire prussienne et raffinement luthérien, rythmée par l’étude des langues, de la musique et des codes de la cour. Les séjours fréquents à Berlin l’initient aux réseaux diplomatiques qui relient la Prusse au reste de l’Europe. Dès l’adolescence, sa vivacité intellectuelle et sa capacité d’adaptation attirent l’attention des envoyés russes en quête d’une épouse pour le grand-duc Pierre, héritier présomptif d’Élisabeth Petrovna. En 1744, Sophie arrive à Saint-Pétersbourg ; elle se convertit à l’orthodoxie sous le nom de Catherine Alexeïevna, démontrant une volonté de se fondre dans l’aristocratie russe. Ses mémoires ultérieures soulignent l’importance de cette mutation culturelle : apprendre la langue, séduire le clergé, comprendre les subtilités du protocole impérial pour survivre à une cour où les intrigues déterminent le destin des princes. Les années qui précèdent son mariage révèlent son caractère ambitieux. Elle s’entoure de mentors russes et étrangers, mémorise les rites de la liturgie orthodoxe, se montre disciplinée lors des leçons de danse et de diplomatie. La jeune duchesse se forge la conviction qu’une souveraine éclairée doit cultiver un savoir encyclopédique, ambition qu’elle poursuivra toute sa vie en lisant Montesquieu, Plutarque ou encore les journaux européens acheminés à Saint-Pétersbourg.
Contexte Historique
Lorsque Catherine arrive en Russie, l’Empire sort transformé des réformes de Pierre le Grand : création d’une flotte, occidentalisation des élites, centralisation bureaucratique. Toutefois, la noblesse demeure attachée à ses privilèges fonciers et les serfs restent soumis à des contraintes sévères. La guerre de Succession d’Autriche puis la guerre de Sept Ans secouent l’équilibre européen, opposant Prusse, Autriche, France et Russie dans un jeu d’alliances mouvantes. La capitale impériale, Saint-Pétersbourg, incarne la volonté d’inscrire la Russie dans le concert des nations occidentales, tandis que Moscou demeure le symbole de la tradition. Élisabeth Petrovna, qui règne de 1741 à 1761, maintient une cour fastueuse mais évite de se marier, laissant à son neveu Pierre l’héritage du trône. Ce dernier, élevé en Holstein et admirateur fervent de la Prusse, suscite la méfiance des aristocrates russes. La question de la succession inquiète d’autant plus qu’Élisabeth n’a pas d’enfant. Catherine comprend très tôt que la légitimité impériale reposera sur sa capacité à donner un héritier, à maîtriser les factions militaires et à parler au nom des grandes familles qui contrôlent le Sénat gouvernant et les régiments de la garde. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, mais aussi de l’intensification de la servitude paysanne et de l’expansion impériale. La Russie, vaste, peuplée de nombreuses minorités, doit concilier ses aspirations européennes et ses réalités asiatiques. Catherine s’inscrit dans ce contexte paradoxal : elle admire Voltaire et Diderot, tout en s’appuyant sur une armée disciplinaire et une noblesse propriétaire pour asseoir son pouvoir. Cette tension structurera l’ensemble de son règne.
Ministere Public
Mariée à Pierre en 1745, Catherine découvre rapidement les faiblesses du futur tsar : immaturité politique, excentricités prussophiles, incapacité à comprendre l’âme russe. Pendant les années 1750, elle mène une existence prudente, occupant le palais d’Hiver, s’efforçant de gagner la confiance des gardes Preobrajenski et Semionovski, piliers de la sécurité impériale. La naissance de son fils Paul en 1754 puis de sa fille Anne en 1757 renforce sa position. Parallèlement, elle entretient un cercle de correspondants européens, lit clandestinement les œuvres de Rousseau et de Beccaria, réfléchissant à l’art de gouverner. La guerre de Sept Ans bouleverse l’ordre international. À Saint-Pétersbourg, la noblesse s’inquiète des sympathies prussiennes de Pierre, qui souhaite restituer à la Prusse les conquêtes russes. Lorsque Élisabeth meurt en janvier 1762, Pierre III accède au trône et multiplie les maladresses : il promeut des officiers holsteinois, envisage de vendre la Livonie, opprime le clergé orthodoxe. Catherine, soutenue par Grigori Orlov et ses frères, organise un complot en coordination avec les régiments de la garde. Le 28 juin 1762 (9 juillet nouveau style), elle est proclamée autocrate de toutes les Russies, tandis que Pierre abdique puis meurt en détention quelques jours plus tard. Ce coup d’État marque le début du « ministère » public de Catherine. Elle s’entoure d’alliés fidèles – Nikita Panine, Ivan Betskoï, Grigori Potemkine – et s’engage à régner selon les principes d’un absolutisme éclairé. Dès l’automne 1762, elle confirme la Charte de la noblesse, restaure certaines libertés commerciales, et affirme sa volonté d’élaborer une législation rationnelle, inspirée des lumières mais adaptée aux réalités russes.
Enseignement et Message
Catherine conçoit le pouvoir comme une mission civilisatrice. Son "Instruction" (Nakaz), rédigée entre 1766 et 1768 pour guider la Commission législative, synthétise sa vision : souveraineté indivisible, primauté de la loi, humanisation des peines, reconnaissance des différents ordres sociaux. Elle puise dans Montesquieu l’idée de la séparation des pouvoirs, mais estime que l’immensité russe exige un monarque fort. Influencée par Beccaria, elle condamne la torture et la peine de mort, même si ces principes demeurent partiellement appliqués. Son message politique s’exprime aussi par le mécénat. Elle acquiert la bibliothèque de Diderot, commande à Falconet la statue équestre de Pierre le Grand (le Cavalier de bronze), fonde des écoles pour jeunes filles nobles (Smolny) et invite des architectes européens à moderniser les villes russes. Par ses manifestes, elle présente la Russie comme un empire éclairé qui protège la religion orthodoxe, soutient les sciences et développe l’économie. Dans ses lettres à Voltaire, elle se met en scène comme « Sémiramis du Nord », souveraine capable de conjuguer autorité et raison. Cette rhétorique masque toutefois la permanence de la servitude paysanne. Catherine tente d’équilibrer ses discours humanistes avec la nécessité de préserver le soutien de la noblesse. Elle accorde en 1767 une Charte aux cosaques du Don, encourage la colonisation des steppes par des paysans libres, mais renforce les obligations des serfs envers leurs seigneurs. Sa propagande impériale célèbre les victoires militaires et la stabilité, consolidant l’image d’une autocrate éclairée mais consciente des limites structurelles de la société russe.
Activite En Galilee
Les premières années du règne voient une intense activité intérieure. La Commission législative, réunie en 1767 avec des députés de toutes les provinces et de toutes les catégories sociales (à l’exception des serfs dépendant directement de la noblesse), discute du projet de code inspiré du Nakaz. Bien que la guerre russo-turque de 1768 interrompe les travaux, cette assemblée représente une tentative inédite de consultation à l’échelle impériale. Catherine fait établir des statistiques, cartographier les gouvernements, et ordonne la compilation d’inventaires des ressources minières et forestières. Parallèlement, elle réforme l’éducation. Avec Ivan Betskoï, elle fonde en 1764 l’Institut Smolny pour les jeunes filles nobles, conçoit des manuels pédagogiques, soutient la création d’imprimeries provinciales. Les universités de Moscou et Saint-Pétersbourg bénéficient d’un afflux de professeurs étrangers. Les académies des sciences et des arts reçoivent des budgets accrus, permettant la publication des premiers recueils ethnographiques sur les peuples sibériens et finno-ougriens. Dans les campagnes, Catherine encourage l’introduction de la pomme de terre, la modernisation des techniques de filature, l’exploitation des gisements de cuivre et de fer de l’Oural. Elle signe des manifestes invitant les colons européens – Allemands de la Volga, Suisses, Serbes – à s’installer dans les régions frontières, promettant exemptions fiscales et liberté religieuse. Cette politique migratoire renforce la présence impériale dans la Volga, le Caucase et la steppe pontique, tout en accentuant les contrastes entre paysans libres et serfs soumis.
Montee A Jerusalem et Conflit
La consolidation du pouvoir de Catherine n’échappe pas aux crises. La révolte de Pougatchev (1773-1775), soulèvement massif de cosaques, paysans et minorités ethniques de la Volga, menace l’édifice réformateur. L’usurpateur Iemelian Pougatchev se fait passer pour Pierre III, promet l’abolition du servage et attire des milliers d’insurgés. Catherine mobilise l’armée commandée par Michelson et Souvorov : après des combats sanglants, Pougatchev est capturé et exécuté à Moscou. L’impératrice profite de la victoire pour réorganiser la Russie intérieure : le Statut provincial de 1775 divise le territoire en gouvernements plus petits, place des gouverneurs responsables devant le Sénat, renforce la justice locale. Les tensions se manifestent également à la cour. Les favoris – Grigori Orlov, puis Grigori Potemkine, Alexandre Lanskoi, Platon Zoubov – jouent un rôle politique en échange d’alliances et de privilèges. Potemkine, en particulier, dirige la colonisation du sud, fonde Sébastopol, développe la flotte de la mer Noire. La correspondance entre Catherine et Potemkine révèle une vision stratégique ambitieuse : créer un « projet grec » visant à affaiblir l’Empire ottoman et à restaurer un État chrétien en Méditerranée orientale. Sur le plan idéologique, Catherine doit arbitrer entre l’ouverture et la censure. Après la Révolution française de 1789, elle interdit la diffusion des pamphlets révolutionnaires, ferme les loges maçonniques suspectes, surveille les voyages à l’étranger. Le conflit avec les idées démocratiques montre les limites de son absolutisme éclairé : la souveraine défend la rationalité et la culture européenne tant qu’elles ne menacent pas l’ordre monarchique.
Sources et Temoinages
Les historiens disposent d’une documentation abondante sur Catherine II : ses mémoires, ses lettres à Voltaire, Grimm, Diderot, Potemkine, les rapports du Sénat gouvernant, les ukazes publiés dans le Messager russe, les journaux de cour comme ceux d’A. V. Khrapovitski. Les ambassadeurs étrangers – anglais, français, autrichiens – transmettent des dépêches détaillées sur la politique intérieure et extérieure. Les archives militaires conservent les ordres adressés à Roumiantsev, Souvorov, Potemkine pendant les guerres contre l’Empire ottoman et la Pologne. Parmi les témoignages contemporains, la « Description de la Russie » de William Coxe (1780), les récits de voyage de Johann Gottlieb Georgi et les analyses de l’économiste français Jacques Necker offrent des perspectives européennes sur son règne. Les philosophes des Lumières, séduits par la figure de la souveraine réformatrice, la comparent aux héros antiques. Toutefois, les correspondances privées dévoilent aussi les contradictions : demandes d’exemption pour la noblesse, plaintes contre les abus administratifs, inquiétudes face aux révoltes paysannes. Les historiens modernes – Isabel de Madariaga, Lindsey Hughes, Simon Dixon – croisent ces sources pour nuancer l’image officielle. Ils montrent une souveraine pragmatique, oscillant entre l’idéologie éclairée et la défense des intérêts aristocratiques, capable d’utiliser la propagande artistique et la diplomatie pour consolider sa légitimité.
Interpretations Historiques
Depuis le XIXe siècle, l’historiographie de Catherine la Grande reflète les débats sur la modernisation russe. Les slavophiles et occidentalistes du XIXe siècle voient en elle soit une trahison des traditions nationales, soit une pionnière de l’européanisation. Les historiens soviétiques soulignent les contradictions de son règne : expansion impériale et durcissement du servage. Après 1991, les études mettent l’accent sur ses innovations administratives, son usage de l’information, sa maîtrise de la communication politique. Les biographies récentes insistent sur l’expérience personnelle de Catherine : femme souveraine dans un monde masculin, elle manipule les représentations du pouvoir pour affirmer sa légitimité. Les chercheurs analysent ses portraits officiels, ses spectacles de cour, les fêtes orchestrées lors des victoires militaires. L’idée d’un « absolutisme éclairé » est discutée : certains y voient une synthèse réussie entre autorité et rationalité, d’autres soulignent l’écart entre discours et pratiques, notamment à l’égard des serfs et des minorités. La réception littéraire et artistique participe à cette diversité d’interprétations. De Pouchkine à Tolstoï, de la peinture néoclassique aux séries contemporaines, Catherine reste un symbole ambivalent : stratège ambitieuse, mécène éclairée, autocrate autoritaire. Cette pluralité nourrit les débats historiographiques et l’intérêt du grand public pour son parcours.
Heritage
À sa mort en 1796, Catherine laisse un empire agrandi, administrativement structuré et culturellement vibrant. La Russie s’est affirmée comme grande puissance européenne, dotée d’une flotte en mer Noire, présente dans les affaires polonaises et ottomanes. Les institutions éducatives qu’elle a fondées forment une élite capable de servir l’État. Les collections d’art rassemblées pour l’Ermitage deviennent un patrimoine mondial. Cependant, son héritage est ambivalent : l’extension du servage et la centralisation autoritaire prépareront les crises du XIXe siècle. Paul Ier, son fils, tentera de revenir sur certaines politiques, sans effacer l’empreinte de sa mère. Au XXe siècle, Catherine est tour à tour exaltée comme pionnière féminine du pouvoir, critiquée pour son absolutisme, récupérée comme symbole de grandeur nationale. Dans la mémoire collective, elle incarne l’idée d’un leadership féminin audacieux, capable de transformer la Russie en acteur majeur des Lumières tout en révélant les limites d’une modernisation sans remise en cause sociale profonde. Son nom reste associé à l’Ermitage, aux conquêtes de la mer Noire, à la correspondance avec Voltaire, et à une certaine vision du despotisme éclairé qui fascine toujours historiens, artistes et visiteurs du musée impérial.
Réalisations et héritage
Principales réalisations
- Publication du Nakaz et convocation de la Commission législative
- Réorganisation administrative de l’Empire russe en 1775
- Annexion de la Crimée et expansion en mer Noire
- Fondation de l’Ermitage impérial et mécénat artistique
Héritage historique
Impératrice emblématique de l’absolutisme éclairé, Catherine II a façonné la Russie moderne par ses réformes administratives, son expansion territoriale et son mécénat. Elle a inscrit Saint-Pétersbourg au cœur de la culture européenne tout en consolidant l’autocratie. Son nom évoque l’Ermitage, les conquêtes en mer Noire, la correspondance avec les philosophes et l’ambivalence d’une modernisation qui laissa subsister le servage.
Chronologie détaillée
Événements majeurs
Naissance
Naissance à Stettin, duché de Poméranie, dans une famille princière allemande
Arrivée en Russie
Sophie d’Anhalt-Zerbst est invitée à Saint-Pétersbourg et se convertit à l’orthodoxie
Coup d’État
Renversement de Pierre III et proclamation de Catherine comme impératrice
Commission législative
Convocation de représentants provinciaux pour élaborer un code inspiré du Nakaz
Réformes provinciales
Statut provincial réorganisant l’administration de l’Empire
Annexion de la Crimée
Intégration de la Crimée et fondation de Sébastopol sous la direction de Potemkine
Mort
Décès à Saint-Pétersbourg après trente-quatre ans de règne
Chronologie géographique
Citations célèbres
« Le pouvoir sans la confiance du peuple est la plus fragile des constructions. »
« Il faut instruire pour gouverner ; sans lumières, l’autorité n’est qu’un glaive dans les ténèbres. »
« La Russie est un empire ; il faut qu’elle regarde vers toutes les mers. »
Liens externes
Questions fréquentes
Quand Catherine la Grande est-elle montée sur le trône ?
Elle devint impératrice de Russie le 9 juillet 1762, à la suite d’un coup d’État qui renversa son époux Pierre III.
Quelles réformes majeures a-t-elle engagées ?
Catherine II mena l’élection et la codification juridique via la Commission législative, réorganisa l’administration provinciale, modernisa l’éducation et encouragea l’essor économique.
Quel fut son rôle dans l’expansion de l’Empire russe ?
Sous son règne, la Russie annexa la Crimée, participa aux partitions de la Pologne et étendit son influence en mer Noire et dans le Caucase.
Entretenait-elle des liens avec les philosophes des Lumières ?
Oui, elle correspondait avec Voltaire, Diderot et d’autres penseurs, finançant la diffusion de leurs œuvres tout en adaptant leurs idées au contexte autocratique.
Comment se termina son règne ?
Catherine II mourut d’une attaque cérébrale le 17 novembre 1796 au palais d’Hiver, laissant le trône à son fils Paul Ier.
Sources et bibliographie
Sources primaires
- Catherine II – Correspondance avec Voltaire
- Catherine II – Nakaz (Instruction) à la Commission législative
- Catherine II – Mémoires
Sources secondaires
- Isabel de Madariaga – Russia in the Age of Catherine the Great ISBN: 9780300103229
- Lindsey Hughes – Catherine the Great: A Short History ISBN: 9780300103007
- Simon Dixon – Catherine the Great ISBN: 9781844135232
- Marc Raeff – Origins of the Russian Intelligentsia ISBN: 9780156716001
- Alexander Woronzoff-Dashkoff – The Journal of Russian Nobility
- William Coxe – Travels into Poland, Russia, Sweden
- Jean-Marie Huret – Catherine II, impératrice de toutes les Russies ISBN: 9782213618210
Références externes
Voir aussi
Personnages connexes
Sites spécialisés
Batailles de France
Découvrez les batailles liées à ce personnage
Dynasties Legacy
BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires
Timeline France
BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique